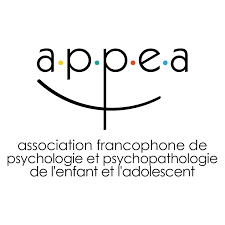Amèle Al Achhab1 et René Pry2
Résumé
La consanguinité est le plus souvent décrite comme un facteur de risque dans la transmission de syndromes génétiques et de particularités dans les développements sensoriels, cognitifs et moteurs. L’apparition récente de la notion de « troubles neurodéveloppementaux » oblige à se demander si ces derniers sont aussi associés à cette situation. Les résultats actuels ne vont pas dans ce sens et autorisent à se demander si le mode de transmission de type autosomique récessif est une condition suffisante à l’apparition de ces troubles.
Mots clés
Troubles neurodéveloppementaux, consanguinité, facteurs génétiques, facteur de risque.
Abstract
Consanguinity is most often described as a risk factor in the transmission of genetic syndromes and particularities in sensory, cognitive and motor developments. The recent appearance of the notion of “neurodevelopmental disorders” requires us to ask ourselves whether these are also associated with this situation. The current results do not point in this direction and raise the question of whether the autosomal recessive mode of inheritance is a sufficient condition for the appearance of these disorders.
Keywords
Neurodevelopmental disorders, consanguinity, genetic factors, risk factor.
Introduction
La consanguinité indique le fait que les parents d’une personne donnée ont un lien de parenté. Elle est plus courante dans certaines cultures et régions où les mariages entre cousins sont traditionnels. Les unions consanguines sont très répandues en Afrique du Nord, en Asie centrale et occidentale et en Asie du Sud. Il a été suggéré que la consanguinité avait des effets néfastes sur le développement de l’enfant, mais évaluer
1 Université Mohamed VI et Chaalet Jonas. Casablanca Maroc
2 Professeur émérite de Psychologie. Université Lyon 2. France
son impact n’est pas simple, car la décision d’épouser un parent pourrait être endogène à d’autres facteurs socio-économiques. À l’aide d’un ensemble de données recueilli dans les zones rurales du Pakistan, Mete (Mete et al., 2020) a évalué dans quelle mesure la consanguinité est liée au développement cognitif et physique des enfants. Il exploite la propriété foncière des grands-pères (actuelle et passée) et la mortalité des grands parents maternels pour identifier l’effet de la consanguinité endogène sur le développement. Les enfants nés d’unions consanguines ont des scores cognitifs plus faibles, une taille par rapport à l’âge plus faible et une probabilité plus élevée de souffrir d’un retard de croissance sévère. Plus importants encore, les effets néfastes sont plus importants après avoir pris en compte l’endogénéité de la consanguinité, ce qui suggère que les impacts sur le développement de l’enfant sont substantiels et probablement plus importants que ce que suggéraient les études précédentes.
Méthode
Une revue de la littérature internationale a été réalisée en août 2024 en utilisant les bases de données Medline, PsycINFO et CINAHL avec les termes de recherche suivants : neurodevelopmental disorder consanguinity, neurodevelopmental disorder genetic factors, neurodevelopmental disorder hereditary factors et neurodevelopmental disorder consanguinity study. Ont été ensuite déclinés les différents troubles neurodéveloppementaux : Autism spectrum disorder, attention deficit disorder, motor disorder, communication disorder, learning disorder et intellectual developmental disorder associés à consanguinity. Seuls les articles parus après 2019 (inclus) ont été retenus3. Les articles analysés devaient de plus communiquer des informations sur la prévalence du trouble, leur description clinique, et leur congruence avec leur définition actuelle. Au total 28 articles ont été examinés. La très grande majorité était consacrée aux troubles du développement intellectuel et au trouble du spectre de l’autisme. Aucun ne portait sur le trouble développemental de la coordination ou sur le syndrome de Gilles de la Tourette. De même, le trouble développemental du langage et les troubles de la parole ne semblent avoir suscité aucune étude dans leur rapport à la
3 Il fallait limiter les références bibliographiques entrant dans le cadre d’un article.
consanguinité. Enfin, nous ne disposons actuellement d’aucune méta-analyse traitant de cette question.
Les Troubles neurodéveloppementaux (TND)
C’est aux États-Unis, dans les années 70 qu’est apparue pour la première fois, sous la plume de Michael Rutter (1933-2021), la notion de « Developmental Disabilities ». Cette notion englobait les troubles sensoriels, les retards mentaux et tous les anciens « dys ». Elle se caractérisait par un début précoce, un déficit fonctionnel en lien avec la maturation du système nerveux central et une stabilité évolutive.
La notion de « Troubles neurodéveloppementaux » (TND), quant à elle, a été introduite dans la dernière classification américaine des troubles mentaux (American Psychiatric Association, (DSM-5), (2013, 2022) ; dans celle de l’Organisation mondiale de la santé [World Health Organization, 2021] et par la Word Psychiatric Association. Elle a remplacé celle de « Troubles de la première, de la deuxième enfance ou de l’adolescence » qui était décrite dans le DSM-IV).
L’apparition officielle des TND en 2013 rencontra rapidement un certain succès dans la mesure où les critères de publications, notamment ceux de la NIMH (National Institute of Mental Health) conseillaient vivement de coupler des observables comportementaux à des observables « neuro ». Cela étant dit, ce changement dans les concepts, a été diversement interprété par certains cliniciens qui y ont vu, pour certains, la volonté de fixer l’origine des particularités développementales rencontrées durant l’enfance dans le développement cérébral et pour d’autres, celle de réduire ainsi la dimension « psychique » ou subjective à des données observables. On notera également que, lorsqu’un diagnostic de TND est correctement posé, il l’est généralement pour toute la vie, tout en sachant qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre un changement dans la formulation clinique du trouble et l’avancée en âge, et ceci, même si la stabilité au cours du développement des critères cliniques proposés dans les nosographies ne va pas vraiment dans ce sens.
Parmi les autres critiques figurent les positions nouvelles portant sur la « différence » et la « neurodiversité » qui consistent à dire que l’on est peut être face à un neurodéveloppement « original » et pas obligatoirement « troublé », que les étiologies
dans les TND sont multifactorielles, et que l’on comprend mal pourquoi il faudrait en privilégier une, qu’il n’existe à ce jour aucun critère neuro (psychologique, physiologique) pour les définir, et que, comme pour l’homosexualité dans les années 80, il n’y a aucune légitimité à les considérer comme des « troubles mentaux ».
De fait, il s’agissait probablement pour leurs auteurs de cette notion de rendre solidaire sous un même concept, le développement cérébral, celui des comportements et celui de la subjectivité, telle qu’elle est rapportée par le langage, sans que l’on puisse donner une primauté de l’un d’entre eux sur les autres.
Cette notion de TND renvoie aux 6 conditions suivantes : Troubles du développement intellectuel (TDI) ; Troubles moteurs (TM) ; Troubles de la communication (TC) ; Trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDA/H) ; Trouble spécifique des apprentissages (TA) et Trouble du Spectre de l’autisme (TSA). Chaque condition se déclinant en sous conditions. Par exemple les Troubles moteurs comprennent le Trouble développemental de la Coordination, les Mouvements stéréotypés, le Syndrome de Gilles de la Tourette et autres Tics.
Les prévalences4 moyennes sont de l’ordre de 0,5 à1 % pour le TSA ; 1,5 à 2,5 % pour les TDI ; 5 à 6 % pour le TDA/H ; 2,7 à 10 % pour la dyslexie, 3,6 à 6,5 % pour la dyscalculie ; 1 à 7 % pour les Troubles moteurs et 6 % pour les Troubles de la communication.
Les facteurs de haut risque peuvent être classés dans 3 catégories :
• Des déterminants génétiques tels la présence d’un frère ou sœur ou parent de 1er degré ayant un TND, et celle de syndromes génétiques pouvant affecter le neurodéveloppement.
• Des déterminants environnementaux comme l’exposition prénatale à un toxique majeur du neurodéveloppement (alcool, certains antiépileptiques…), une chirurgie majeure (cerveau, abdomen, thorax) ou des infections congénitales ou néonatales (CMV, toxoplasmose, rubéole, méningites…), des encéphalites aiguës néonatales (incluant des convulsions) ou des cardiopathies congénitales complexes opérées.
4 Enquête ENABEE, Mars 2023, 8172 enfants de 6 à 11 ans.
• Des déterminants développementaux tels une grande prématurité (moins de 32 semaines d’aménorrhée), un poids de naissance inférieur à 1500 g, une microcéphalie (PC>-2ds, congénitale ou secondaire, des anomalies cérébrales de pronostic incertain (ventriculomégalie, agénésie du corps calleux…) ou un ictère néonatal sévère, y compris à terme (bilirubine > 400 mmol/l).
Nous savons que ces troubles se manifestent précocement, mais que leur diagnostic peut être tardif. Ce dernier est proposé généralement dans les six premières années de la scolarité, c’est-à-dire entre 3 et 8 ans (excepté pour les formes graves du trouble du développement intellectuel qui peut être fait plus précocement, et pour les formes de TSA prototypiques qui peuvent être identifiées dés 24 mois). Les déterminants du diagnostic dépendent de l’interaction entre l’âge de l’enfant et le contexte (aggravant versus facilitant) (Nolen-Hoeksema & Watkins, 2011). Leur formulation clinique au moment du diagnostic est différente de celle des premiers signes et il existe probablement une souche développementale commune (Gillberg, 2019). Chacun de ces troubles est très hétérogène sur le plan du phénotype (approche dimensionnelle et notion de spectre).
Ils peuvent être associés entre eux et par conséquent leur symptomatologie n’est pas spécifique. Quand ils le sont, la sévérité est plus importante, mais ils peuvent aussi être associés à d’autres troubles ou à d’autres conditions médicales. Ils ont un retentissement fonctionnel, personnel, social, scolaire ou professionnel (notion de « handicap ». Leurs trajectoires évolutives sont plurielles et difficiles à pronostiquer. Et, enfin, ils posent autrement la question des interventions dans le cadre d’un développement contraint : position éducative vs thérapeutique.
Les TND peuvent être associés entre eux : notion de comorbidités et/ou de chevauchement clinique. À cet égard, le cas du TSA est assez exemplaire : dans 70 % des cas on trouve en effet une « comorbidité » associée et dans 40 % deux « comorbidités ». De même, 1/3 des personnes avec TSA présentent un TDAH (Lai et al., 2019) et 15 % des sujets avec TDAH présentent également un TSA (Grzadzinski et al., 2016).
Dans la figure suivante est synthétisé l’ensemble des données concernant ces associations.
Figure 1. Associations entre les différents TND et d’autres troubles
Dans le cadre d’une démarche clinique, les tableaux présentés relèvent alors le plus souvent d’un diagnostic complexe.
Consanguinité et génétique
Le lien de consanguinité est généralement classé par niveau : une consanguinité de premier niveau implique des parents et des enfants, ou des frères et sœurs ; une consanguinité de deuxième niveau mêle des oncles/tantes avec leurs neveux/nièces, ou des grands-parents avec leurs petits-enfants, et enfin une consanguinité de troisième niveau et au-delà inclut les cousins germains et les cousins éloignés.
On peut exprimer ce lien par un coefficient de consanguinité (F) : il (F) mesure la probabilité qu’un individu hérite de deux allèles identiques pour un gène. Par exemple, le F pour des frères et sœurs est de 0,25, tandis que pour des cousins germains, il est de 0,062 5. La consanguinité augmente donc la probabilité que les deux parents aient des allèles (versions de gènes) identiques à un locus (emplacement précis sur un chromosome). Si ces allèles présentent des conditions délétères, ils s’exprimeront sous la forme de « maladies récessives » ou de « troubles autosomiques récessifs ».
On observe donc, dans les situations de consanguinité, une augmentation de la morbidité et de la mortalité dues à des troubles génétiques, à des malformations
congénitales, et à un impact sur la fitness génétique de la population. On peut citer, à titre d’exemple, la Thalassémie, la Mucoviscidose (Fibrose kystique), le Syndrome de Tay-Sachs, ou encore la Maladie de Gaucher.
Il est donc tout à fait légitime de se demander si la consanguinité favorise l’apparition des troubles du neurodéveloppement, tout au moins tels qu’ils sont définis dans les nosographies actuelles, même si la consanguinité n’est pas caractérisée à ce jour comme un facteur de haut risque.
Sur les 30 000 gènes codants, environ 6 000 (20 %) participeront au développement cérébral. À ce jour, aucun gène spécifique n’a été identifié pour 1 TND donné, et cependant il existe une forte contribution génétique dans ces troubles (notion d’héritabilité). Par exemple l’héritabilité du TSA est estimée à 70 %-80 %. On estime que 1732 gènes pourraient être associés aux TND, dont 200 aux TSA, au TDI et à l’épilepsie.
Cette contribution peut être décrite en termes de prédisposition (augmente la probabilité de) et de susceptibilité (représentable sur une échelle en 5 niveaux : de pathogène à bénin). Elle peut être transmissible (réplication, transcription, traduction), relever de mutations de novo (embryogenèse ou gamétogénèse chez un des parents), ou d’erreurs épigénétiques.
Elle permet d’identifier trois types d’erreurs : les SNV (Single Nucleotide Variant), qui sont des erreurs de traduction dans les nucléotides, les CNV (Copy Number Variation), qui sont des erreurs d’organisation, et les BCA (Balanced Chromosomal Abnormality), qui sont des erreurs chromosomiques : duplication, translocation.
Le poids de ce déterminisme génétique n’est pas le même entre les formes « pures » du trouble, et les formes dans lesquelles il est associé à d’autres conditions médicales où la contribution est souvent plus importante5. Cette contribution peut se repérer sur le morphotype : présence de macrocéphalie, dysmorphie faciale…
Enfin, cette contribution se modifie avec le développement : pour un phénotype donné, la part de variance moyenne imputable au patrimoine génétique oscille entre 20 %
5 Distinction entre forme “non-syndromique » (pure, franche, DSM-5) et forme « syndromique » (associée à un syndrome génétique). Chez le petit enfant, 40 % chez l’enfant et entre 60 % à 80 % chez l’adulte (notion d’environnement « imposé » et d’environnement « choisi »).
Cet échec relatif dans la recherche des gènes « coupables » a conduit les chercheurs à modifier profondément leur méthodologie, et à introduire les études GWAS (études d’association pangénomique6). Les études GWAS consistent à établir une corrélation entre l’expression d’un trait dans un groupe et des marqueurs de leur génome. Dans cette perspective les TND sont alors considérés comme des variables continues, et leurs diagnostics effectués à partir d’échelles unidimensionnelles. C’est ainsi que l’on parle de « trait autistique », de « trait attentionnel », de trait schizophrénique »…
D’un point de vue pratique, on compare les marqueurs génétiques « snip », dans un groupe présentant le trouble à un groupe témoin ne le présentant pas à l’aide de puces à ADN. La taille des effets de chaque « snip » est très faible (0,01 %) et des milliers de « snip » sont nécessaires pour expliquer l’héritabilité. Il reste à affecter à chaque différence génétique identifiée un coefficient censé représenter la force de son association avec le trait, et on calcule un score global appelé « score polygénique »
Ce score polygénique va alors représenter l’intensité du risque en termes de probabilité. Les prédictions actuelles concernent les troubles bipolaires, les troubles dépressifs, les troubles schizophréniques, la maladie d’Alzheimer et même le niveau d’instruction.
Cette méthode, aussi attractive soit-elle, est très coûteuse en nombre de sujets et surtout, nécessite de replacer la psychopathologie dans une perspective dimensionnelle et de considérer les caractéristiques humaines et les troubles comme étant des traits et des dimensions continues : anxiété, dépression, intelligence, autisme…, et les extrémités de ces traits comme relevant de la pathologie.
Cette position n’est pas compatible avec la position nosographique actuelle (DSM-5, CIM-11) qui définit un trouble comme association non fortuite de critères. La question reste donc ouverte, et divise le monde de la recherche.
6 GWAS: genome-wide association study,
Dans les populations à forte consanguinité parentale, la méthode actuellement privilégiée est l’analyse par séquençage à haut débit (NGS). Dans la mesure où dans ces populations le modèle de transmission est un modèle de transmission autosomique récessive (mutation transmise par le père et la mère sur un chromosome qui n’intervient pas dans la détermination du sexe), c’est généralement le choix le plus évident pour l’analyse des données. En conséquence, les mutations hétérozygotes (présentes sur un seul des deux chromosomes de la paire) peuvent être négligées dans les familles consanguines.
Consanguinité et TND
De manière générale, dans les travaux les plus récents, les auteurs semblent identifier des formes de TND qui, par définition, sont qualifiées de syndromiques. Elles concernent le plus souvent la moitié de l’échantillon. Ces formes ont la particularité de se présenter sur le plan des comportements, dans une formulation qui est celle d’un TND, mais dont l’étiologie génétique est identifiée. Se pose alors légitimement la question d’une phénocopie à savoir celle d’un syndrome génétique bien particulier qui viendrait mimer la clinique du TND sans en partager les caractéristiques évolutives (Maj, 2005).
Dans une enquête menée aux Émirats arabes, Saleh (Saleh et al. 2021), 506 patients présentant un retard de développement, une DI, des difficultés d’apprentissage, un TSA, un TDAH ou des TND ont été inclus (61,8 % d’hommes et 38,2 % de femmes). Des antécédents familiaux positifs de TND ont été documentés dans 132 familles, tandis que 115 familles avaient des antécédents négatifs et les antécédents familiaux étaient inconnus/peu clairs dans les autres. Des troubles génétiques ont été détectés chez 133 patients (67,5 % et des erreurs innées du métabolisme ont été détectées chez 42 patients (21,3 %). La consanguinité a été documentée chez 139 patients avec des diagnostics moléculaires positifs (70,5 %). Cette étude montre que les troubles neurodéveloppementaux se présentent de façon très hétérogène aux niveaux clinique et moléculaire. En utilisant la micropuce, le WES et le WGS, un diagnostic a été posé chez 50 % des patients, tandis qu’aucun diagnostic n’a été posé chez l’autre moitié des patients étudiés.
Dans une approche plus clinique, Susgun (Susgun et al., 2024) présente une grande famille consanguine de Turquie, qui souffre de TND. Ils concluent qu’une consanguinité peut conduire à la révélation de troubles neurodéveloppementaux « « rares et distincts, dans une seule famille tout en sachant que le séquençage de l’exome7 est généralement considéré comme le test diagnostique de premier niveau chez les personnes présentant 1 TND.
1. Consanguinité et Troubles du développement intellectuel (Handicap intellectuel) Les troubles du développement intellectuel (TDI ou Handicaps intellectuels dans le DSM-5) sont un groupe hétérogène de troubles neurodéveloppementaux caractérisés par une altération significative du fonctionnement intellectuel et adaptatif qui apparaît au cours de la période de développement. Malgré les avancées médicales incessantes, on observe dans le champ du TDI des « problèmes monumentaux s’accompagnant de controverses monumentales » (Hodapp et Dykens, 2009). Ces problèmes sont posés par :
• Les avancées dans la prédiction : conseil génétique, diagnostic précoce, l’ARN CRISPR, thérapie épigénétique (inactivation)…
• La stabilité de la prévalence (l’augmentation de la prévalence de la prématurité, formes nouvelles liées à des grossesses particulières : toxicomanies et développement fœtal…).
• La reconnaissance de deux formes de TDI : TDI syndromiques et TDI non syndromiques. Les TDI non syndromiques, appelés également : TDI normal, endogène, familial ou culturel familial8 qui se caractérise par des catégories socioprofessionnelles (CSP) basses chez les Parents, des conditions alimentaires souvent compliquées et un patrimoine génétique particulier qui reste à identifier par les études GWAS. Les TDI syndromiques (pathologique, exogène ou organique) se caractérisent quant à elles par la présence d’une étiologie clairement identifiée : atteinte accidentelle du système nerveux (toxique, infectieuse, traumatique ou génétique).
7 Désigne une petite partie du génome, environ 1,5%, ciblée sur les 20 000 gènes et qui regroupe plus de 85% des mutations associées aux maladies génétiques.
8Ils sont remplacés aujourd’hui par les notions de désavantage psycho-social ou de déprivation environnementale.
Les TDI sont donc des troubles très hétérogènes concernés par plus de 700 gènes et pourtant, malgré les progrès réalisés dans l’identification des causes génétiques du TDI à la suite de l’introduction du séquençage à haut débit, environ la moitié des individus affectés restent toujours sans diagnostic moléculaire.
Les anomalies génétiques autosomiques récessives (AGAR) sont la principale cause génétique des TDI dans les pays où la consanguinité parentale est fréquente, ce qui représente environ 1/7 de la population mondiale (Hu et al., 2019). Pourtant, par rapport aux mutations autosomiques dominantes de novo (mutations spontanées), qui sont la cause prédominante de TDI dans les pays occidentaux, l’identification des gènes AGAR spécifiques aux TDI a pris du retard. Par ailleurs, dans la mesure où la distinction entre les deux formes, syndromiques et non syndromiques, n’est pratiquement jamais prise en compte dans les recherches, il est difficile d’affirmer que la situation de consanguinité est un facteur d’aggravation dans la transmission de ces troubles, dans les pays où cette situation est forte.
La plupart des travaux suivants vont ainsi décrire des syndromes autosomiques récessifs complexes, qui se traduiront par une déficience intellectuelle, mais associée à d’autres caractéristiques morpho typiques ou à d’autres conditions médicales, qui relèvent incontestablement de l’appellation « formes syndromiques »
Grigorenko (Grigorenko et al., 2022) présente un travail dans lequel il décrit un syndrome identifié chez deux familles consanguines avec des variants homozygotes susceptibles de modifier l’épissage de l’ATP9A9. Les trois individus homozygotes pour ces variantes putativement tronquées présentaient de graves troubles de l’identité, des troubles moteurs et de la parole, ainsi que des anomalies comportementales.
Moudi (Moudi et al., 2022) ont effectué le séquençage de l’exome entier chez dix patients de cinq familles consanguines iraniennes diagnostiquées avec des troubles neurodéveloppementaux autosomiques récessifs, dont une déficience intellectuelle modérée à sévère, un retard de développement, des convulsions, des problèmes d’élocution, un taux élevé de lactate et un début avant 10 ans.
9 L’ATP9A code pour une flippase lipidique transmembranaire des P4-ATPases de classe II.
En filtrant les données identifiées par WES, ils ont identifié deux nouveaux variants homozygotes10.
Krami et al. 2022 ont identifié un variant homozygote du gène HECW2 chez un sujet issu d’une famille consanguine marocaine, présentant un retard de développement, une déficience intellectuelle, une hypotonie, des crises tonico cloniques généralisées et une tête inclinée persistante.
Mattioli et al., 2023 ont combiné le séquençage de l’exome de familles consanguines avec une caractérisation fonctionnelle qui leur permet d’identifier un nouveau gène d’un trouble neurodéveloppemental. Ils ont ciblé 3 familles consanguines non apparentées présentant des variants homozygotes délétères dans le gène NSUN6. Les individus affectés présentent un retard de développement, une déficience intellectuelle, un retard moteur et des anomalies comportementales.
Biallelic et al., 2019, par une combinaison de séquençage de l’exome et de cartographie de l’homozygotie, ont analysé trois familles consanguines présentant une déficience intellectuelle. Les huit individus affectés des trois familles présentaient un phénotype similaire qui comprenait une déficience intellectuelle, un retard de développement, une petite taille et une légère dysmorphie faciale, principalement un grand nez à extrémité bulbeuse. La similarité phénotypique et l’analyse de ségrégation suggèrent que les variantes bi alléliques du gène FBXL3 lient ce gène à un retard de développement syndromique autosomique récessif.
Sun et al. 2024 présente une famille pakistanaise avec consanguinité parentale. Elle se caractérise par une déficience intellectuelle sévère, une paraplégie spastique et une surdité. Un séquençage de l’exome entier a été réalisé, et des variantes homozygotes dans TMEM141 ont été identifiées. Des résultats aux tests comportementaux ont montré des troubles de la capacité d’apprentissage et de la coordination motrice. L’ensemble de l’analyse des variations panoramiques a révélé que les variations génomiques multilocus de TMEM141, DDHD2 et LHFPL5 provoquaient des phénotypes variables chez ces patients et que, notamment, les variantes de perte de fonction
10 Dans les gènes FBXO31 et TIMM50 et une mutation dans le gène CEP290 chez les probants.
biallélique de TMEM141 étaient responsables de l’a déficience intellectuelle syndromique.
La déficience intellectuelle syndromique (DIS) associée à une microcéphalie primaire est un groupe de troubles neurodéveloppementaux rares présentant une hétérogénéité génétique et clinique extrême. Cette hétérogénéité stratifiée peut être partiellement résolue par des approches génétiques impartiales ciblant le génome avec des technologies de séquençage de nouvelle génération (NGS), y compris le séquençage de l’exome (SE). Mercan (Mercan et al. 2023) ont réalisé une étude qui vise à décortiquer les caractéristiques cliniques et génétiques de cinq cas distincts de DIS. Ont été identifiés des variants bialléliques de perte de fonction dans les gènes WDR62 et AP4M1 dans trois familles, ainsi que des variants de novo dans les gènes SOX11 et TRIO dans deux familles. Ces résultats soulignent l’importance d’utiliser des modèles de transmission multiple dans l’analyse des données NGS.
Masri et al., 2023 présente un échantillon réalisé auprès d’un groupe de 154 enfants jordaniens présentant un retard global du développement/déficience intellectuelle (RGD/DI). : Une consanguinité entre les parents a été rapportée chez 94 d’entre eux (61,0 %) et des antécédents d’autres frères et sœurs affectés chez 22,7 %. Des variants pathogènes ont été rapportés chez 44,8 %, un variant de signification incertaine a été rapporté chez 35,0 %) et un résultat négatif a été rapporté dans 20,1 % des cas. Dans les cas résolus, les maladies autosomiques récessives étaient les plus courantes (47,8 %). Des troubles métaboliques ont été identifiés chez 28,9 % des cas, suivis des encéphalopathies développementales et épileptiques (13,0 %) et des troubles liés au gène MECP2 (10,1 %). Enfin, d’autres troubles monogéniques ont été identifiés chez 47,8 % des sujets.
Benmakhlouf et al. 2020 trouve une corrélation significative entre la DI associée à des causes génétiques et l’augmentation du taux de consanguinité dans la ville de Fès au Maroc et ses régions. Ont été sélectionnés 186 patients diagnostiqués avec DI dans trois centres différents de la ville de Fès. On observe une fréquence élevée de patients masculins (67,2 %). L’âge moyen est de 15,52 ± 6,59 ans (moyenne ± ET), compris entre 2 et 36 ans. L’âge moyen des pères et des mères à la naissance de leur enfant était respectivement de 36 et 28 ans. Plusieurs comportements anormaux ont été observés :
23,1 % de retard d’apprentissage du langage, 17,7 % d’anxiété, 12,9 % d’agressivité, 19,18 % de problèmes de concentration et 5,4 % d’hyperactivité. Les crises d’épilepsie étaient le trouble le plus fréquent (21,72 %), et seuls 25 % des patients atteints d’épilepsie prenaient des antiépileptiques et/ou des neuroleptiques pour prévenir la survenue de crises.
Al-Kasbi et al., 2022 ont recruté 215 patients atteints de DI issus de 118 familles consanguines du Moyen-Orient. Le séquençage de l’exome entier a été réalisé pour 188 individus. L’âge moyen auquel le WES a été réalisé était de 8,5 ans. Des variants pathogènes ou probablement pathogènes ont été détectés dans 27 % des cas. Des variants de signification incertaine ont été observés dans 28 % des familles. Les gènes candidats ayant une possible association avec la DI ont été détectés dans 27 % des cas avec un nombre total de 64 individus affectés. Ces gènes ont déjà été signalés dans une seule famille et provoquent des phénotypes très différents avec un mode de transmission différent.
2. Consanguinité et TSA
La consanguinité étant un facteur de risque supputé pour les maladies autosomiques récessives, les cliniciens devraient donc la rechercher lors de la démarche diagnostique d’un TSA, mais cela n’est pas fait de manière cohérente et systématique (Roy et al. 2020). Par ailleurs, si le TSA est hautement héréditaire, il est génétiquement et phénotypiquement hétérogène, ce qui réduit la capacité d’en identifier les gènes responsables.
Alshaban (Alshaban et al., 2023) a utilisé des données issues du registre national du Qatar pour évaluer le rôle de la consanguinité en tant que facteur de risque de TSA.
Un échantillon de 891 enfants a été sélectionné (âge moyen : 8,3 ans) avec (N = 361) ou sans (N = 530) TSA. Les données sur la consanguinité et les covariables ont été collectées au moyen de questionnaires et d’entretiens. La prévalence de la consanguinité dans l’échantillon global était de 41,2 % sans différence significative entre les cas et les témoins (42,1 % vs 41,3 % ; p = 0,836). En ajusté, selon les analyses de régression logistique multiples, la consanguinité n’était pas associée au risque de TSA.
La même année, Al-Mamari (Al-Mamari et al. 2023) produit une étude visant à évaluer l’impact des variables cliniques et démographiques sur le séquençage de l’exome entier (WES) lorsqu’il porte sur des enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et issus d’une population consanguine. Quatre-vingt-dix-sept enfants ont été inclus dans l’analyse, 63 % étaient des garçons et 37 % des filles. 77,3 % avaient une étiologie syndromique suspectée, dont 68 % présentaient des caractéristiques cliniques du système nerveux central (SNC), tandis que 69 % avaient d’autres systèmes impliqués. Le rendement diagnostique du WES dans la cohorte avec TSA était de 34 %. Les enfants souffrant de convulsions étaient plus susceptibles d’avoir des résultats WES positifs (46 % contre 31 %, p = 0,042). Les sujets suspectés d’étiologie syndromique de TSA n’ont montré aucun impact différentiel significatif sur les données du WES.
Tuncay (Tuncay et al., 2022) a effectué un séquençage du génome entier (WGS) dans une cohorte TSA de 68 individus issus de 22 familles liées par une ascendance commune. Ont été identifiés en moyenne 3,07 millions de variants par génome, dont 112 512 en moyenne étaient rares. Une cartographie des séquences d’homozygotie (ROH) chez les individus affectés a été pratiquée et une homozygotie génomique moyenne de 9,65 %, conforme aux attentes pour plusieurs générations d’unions consanguines a été retrouvée. Ont alors été identifiés des variants exoniques ou de sites d’épissage rares potentiellement pathogènes dans 12 gènes connus (dont KMT2C, SCN1A, SPTBN1, SYNE1, ZNF292) et 12 gènes candidats (dont CHD5, GRB10, PPP1R13B) de TSA. De plus, il a été annoté des variants non codants dans les ROH avec des éléments régulateurs spécifiques au cerveau et identifié des variants putatifs causant des maladies dans des promoteurs et des activateurs spécifiques du cerveau pour 5 gènes connus de TSA et de maladies neurodéveloppementales (ACTG1, AUTS 2, CTNND2, CNTNAP 4, SPTBN4). Ils ont également identifié des variants du nombre de copies dans deux loci connus de TSA et de troubles neurodéveloppementaux chez deux personnes affectées. Au total, ils ont repéré des variants potentiellement étiologiques dans des gènes connus de TSA ou de maladies neurodéveloppementales pour environ 61 % (14/23) des personnes affectées. A été combiné le WGS avec la cartographie de l’homozygotie et les annotations des éléments régulateurs pour identifier les variants
candidats de TSA. Ces analyses s’ajoutent au nombre croissant de gènes et de variantes de TSA et soulignent l’importance de tirer parti de l’ascendance commune récente pour cartographier les variantes de maladies dans les troubles neurodéveloppementaux complexes et syndromiques.
3. Consanguinité et TDA/H
Les recherches spécifiques au TDAH dans les populations consanguines sont limitées, mais ont suggéré dans un premier temps, un lien potentiel entre la consanguinité et les facteurs génétiques contribuant au TDAH, mais ce lien direct entre la consanguinité et la génétique du TDAH en Arabie saoudite nécessite davantage de recherches (Khayat et al., 2024). Par ailleurs, la prévalence accrue de variants génétiques dans les populations consanguines peut contribuer à une incidence plus élevée du TDAH (Mahrous et al., 2024).
4. Consanguinité et Trouble de la Communication
Kamal (Kamal et al., 2022) relate dans une famille iranienne identifiée par séquençage de l’exome entier et confirmée par séquençage de Sanger, la présence de variants du gène ZNF142. Ces variants sont classés comme « pathogènes » et « variants de signification inconnue » sur la base des normes d’interprétation des variations de séquence recommandées par l’ACMG. Ces variants pathogènes entraînent un trouble neurodéveloppemental autosomique récessif avec troubles de la parole et retard de développement. Le probant est un garçon de cinq ans né de parents consanguins. Le variant hétérozygote a été identifié chez le patient présentant une déficience intellectuelle modérée, un retard global du développement, des troubles de la parole et des crises d’épilepsie.
Cet article décrit la sixième famille au monde présentant ces nouveaux variants, mais contrairement aux cas malaisiens, le patient de l’étude ne présente aucune caractéristique faciale similaire à celle des patients de l’étude initiale.
5. Consanguinité et Troubles des apprentissages
Le trouble spécifique des apprentissages (TA) est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par d’importantes difficultés scolaires malgré une intelligence normale et une éducation adéquate. Les difficultés de lecture, d’écriture et de calcul peuvent se
manifester de manière indépendante ou simultanée à différents âges. Les premiers symptômes peuvent apparaître à l’âge préscolaire, notamment des retards dans les compétences sociales, les habiletés motrices et le développement du langage.
Le travail de Bozatli (Bozatli et al., 2024) vise à évaluer la prévalence des enfants d’âge préscolaire à risque de TA et de troubles psychiatriques associés. Les données ont été collectées auprès de 515 enfants d’âge préscolaire dans la ville d’Edirne, en Turquie, à l’aide d’une échelle de dépistage des premiers signes du TA. Des informations sociodémographiques ont été obtenues et les enfants à risque ont été invités à une évaluation psychiatrique. L’âge moyen des participants était de 72,5 ± 5,6 mois. 5,7 % des enfants d’âge préscolaire qui ont participé au questionnaire étaient à risque de TA selon les scores de l’échelle de dépistage. Des facteurs tels que le faible niveau d’éducation du père, le tabagisme de la mère pendant la grossesse, un séjour plus long en unité de soins intensifs néonatals, un temps d’écran plus long et la consanguinité entre les parents étaient associés à un risque accru de TS.
Conclusion
La consanguinité est une situation dans laquelle le mode de transmission des variants pathogènes est de type autosomique récessif. La ou les mutations délétères doivent être transmises par les deux parents et concernent les chromosomes non sexuels. À ce jour, aucune donnée ne permet de dire que les troubles du neurodéveloppement non syndromiques11 obéissent à ce type de transmission. Cela ne veut surtout pas dire que la présence d’un ou plusieurs TND chez un même sujet, dans cette situation, est peu probable. Nous ne disposons à ce jour d’aucune donnée sur la prévalence des TND dans les situations de consanguinité, mais il n’y a aucune raison de penser qu’elle soit différente de la population générale. On peut donc parfaitement être issus d’une union entre des individus ayant des liens de parenté proches, et présenter un TSA associé à TDA/H. Mais il est difficile d’en conclure que ces troubles associés sont imputables à la consanguinité.
11 Les formes « franches » telles qu’elles sont définies dans les nosographies actuelles.
Est-ce à dire pour autant que les variants génétiques présents dans ces troubles ne se transmettent pas sur un mode autosomique récessif ? Est-ce que les résultats obtenus sont contraints par les techniques actuelles, et notamment dans le cadre de l’analyse par séquençage à haut débit (NGS) qui ne permettrait pas de capturer les mutations en jeu ? Est-ce que la méthodologie GWAS permettra, en revanche, de résoudre ces difficultés, quitte à changer de paradigme, celui qui consiste à considérer les TND comme des caractéristiques dimensionnelles et continues, et dont l’existence s’originerait chez les sujets normo typiques, bref, de considérer que l’on puisse décrire chaque TND à une dimension unique. Si on prend l’exemple du TSA qui se définit actuellement par l’association de deux traits indépendants : un trait de socialisation et un trait « d’intérêt de prédilection », leur amalgame dans un seul « trait autistique » n’est pas sans posé problème (excepté peut-être quand le TSA est associé à un TDI sévère).
Les résultats négatifs à ce jour doivent donc s’accompagner d’une certaine prudence Il est donc possible qu’il faille encore attendre la réplication de nouvelles études dans d’autres populations présentant des taux élevés d’unions consanguines, études qui devront alors mobiliser des techniques de plus en plus sophistiquées, pour affirmer que la situation de consanguinité n’à pas d’impact sur la présence des TND.
Références
Al-Kasbi, G., Al-Murshedi, F., Al-Kindi, A., Al-Hashimi, N., Al-Thihli, K., Al-Saegh, A., Al Futaisi, A., Al-Mamari, W., Al-Asmi, A., Bruwer, Z., Al-Kharusi, K., Al-Rashdi, S., Zadjali, F., Al-Yahyaee, S., & Al-Maawali, A. (2022). The diagnostic yield, candidate genes, and pitfalls for a genetic study of intellectual disability in 118 middle eastern families. Scientific Reports, 12(1), 18 862. https://doi.org/10.1038/s41598-022- 22036-z
Al-Mamari, W., Idris, A. B., Al-Thihli, K., Abdulrahim, R., Jalees, S., Al-Jabri, M., Gabr, A., Al Murshedi, F., Al Kindy, A., Al-Hadabi, I., Bruwer, Z., Islam, M. M., & Alsayegh, A. (2023). Applying whole exome sequencing in a consanguineous population with autism spectrum disorder. International Journal of Developmental Disabilities, 69(2), 190‑200. https://doi.org/10.1080/20473869.2021.1937000
Aldera, H., Hilabi, A., Elzahrani, M. R., Alhamadh, M. S., Alqirnas, M. Q., Alkahtani, R., & Masuadi, E. (2022). Do parental comorbidities affect the severity of autism spectrum disorder? Cureus, 14(12), e32702. https://doi.org/10.7759/cureus.32702.
Alshaban, F. A., Aldosari, M., Ghazal, I., Al-Shammari, H., ElHag, S., Thompson, I. R., Bruder, J., Shaath, H., Al-Faraj, F., Tolefat, M., Nasir, A., & Fombonne, E. (2023). Consanguinity as a Risk Factor for Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders. https://doi.org/10.1007/s10803-023-06137-w
American Psychiatric Association. 2013. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). Washington D.C : American Psychiatric Publishing.
Ansar, M., Paracha, S. A., Serretti, A., Sarwar, M. T., Khan, J., Ranza, E., Falconnet, E., Iwaszkiewicz, J., Shah, S. F., Qaisar, A. A., Santoni, F. A., Zoete, V., Megarbane, A., Ahmed, J., Colombo, R., Makrythanasis, P., & Antonarakis, S. E. (2019). Biallelic variants in FBXL3 cause intellectual disability, delayed motor development and short stature. Human Molecular Genetics, 28(6), 972‑979.
Ben-Omran, T., Al Ghanim, A., Yavarna, K., El Akoum, M., Samara, M., Chandra, P., & Al Dewik, N. (2020). Effects of consanguinity in a cohort of subjects with certain genetic disorders in Qatar. Molecular Genetics & Genomic Medicine, 8(1),
e1051. https://doi.org/10.1002/mgg3.1051.
Benmakhlouf, Y., Zian, Z., Ben Makhlouf, K., Ghailani Nourouti, N., Barakat, A., & Bennani Mechita, M. (2020). Intellectual Disability in Morocco : A Pilot Study. Innovations in Clinical Neuroscience, 17(10‑12), 9‑13.
Bozatlı, L., Aykutlu, H. C., Sivrikaya Giray, A., Ataş, T., Özkan, Ç., Güneydaş Yıldırım, B., & Görker, I. (2024). Children at Risk of Specific Learning Disorder: A Study on Prevalence and Risk Factors. Children, 11(7), Article 7.
Faraone, S. V., Banaschewski, T., Coghill, D., Zheng, Y., Biederman, J., Bellgrove, M. A., Newcorn, J. H., Gignac, M., Al Saud, N. M., Manor, I., Rohde, L. A., Yang, L., Cortese, S., Almagor, D., Stein, M. A., Albatti, T. H., Aljoudi, H. F., Alqahtani, M. M. J., Asherson, P., … Wang, Y. (2021). The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 Evidence-based conclusions about the disorder. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.01.022
Froukh, T., Nafie, O., Al Hait, S. A. S., Laugwitz, L., Sommerfeld, J., Sturm, M., Baraghiti, A., Issa, T., Al-Nazer, A., Koch, P. A., Hanselmann, J., Kootz, B., Bauer, P., Al-Ameri, W., Abou Jamra, R., Alfrook, A. J., Hamadallah, M., Sofan, L., Riess, A.,… Buchert, R. (2020 b). Genetic basis of neurodevelopmental disorders in 103 Jordanian families. Clinical Genetics, 97(4), 621‑627. https://doi.org/10.1111/cge.13720
Gholizadeh, M. A., Mohammadi-Sarband, M., Fardanesh, F., & Garshasbi, M. (2022). Neurodevelopmental disorder with microcephaly, hypotonia, and variable brain anomalies in a consanguineous Iranian family is associated with a homozygous start
loss variant in the PRUNE1 gene. BMC Medical Genomics, 15(1), 78. https://doi.org/10.1186/s12920-022-01228-6
Gillberg, C. (2019). The concept of ESSENCE and comorbidity in neurodevelopmental disorders. Enfance, 1(1), 49‑58. (Traduction J. Nadel)
Grigorenko, A. P., Protasova, M. S., Lisenkova, A. A., Reshetov, D. A., Andreeva, T. V., Garcias, G. D. L., Martino Roth, M. D. G., Papassotiropoulos, A., & Rogaev, E. I. (2022). Neurodevelopmental Syndrome with Intellectual Disability, Speech Impairment, and Quadrupedia Is Associated with Glutamate Receptor Delta 2 Gene Defect. Cells, 11(3), 400. https://doi.org/10.3390/cells11030400
Grzadzinski, R., Dick, C., Lord, C., & Bishop, S. (2016). Parent-reported and clinician observed autism spectrum disorder (ASD) symptoms in children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD): Implications for practice under DSM-5. Molecular Autism, 7(1), 7. https://doi.org/10.1186/s13229-016-0072-1
Hiz Kurul, S., Oktay, Y., Töpf, A., Szabó, N. Z., Güngör, S., Yaramis, A., Sonmezler, E., Matalonga, L., Yis, U., Schon, K., Paramonov, I., Kalafatcilar, İ. P., Gao, F., Rieger, A., Arslan, N., Yilmaz, E., Ekinci, B., Edem, P. P., Aslan, M., Horvath, R. (2022). High diagnostic rate of trio exome sequencing in consanguineous families with neurogenetic diseases. Brain, 145(4), 1507‑1518.
Hodapp, R. M., & Dykens, E. M. (2009). Intellectual disabilities and child psychiatry: Looking to the future. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50(1‑2), 99‑107. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2008.02038.x
Hu, H., Kahrizi, K., Musante, L., Fattahi, Z., Herwig, R., Hosseini, M., Oppitz, C., Abedini, S. S., Suckow, V., Larti, F., Beheshtian, M., Lipkowitz, B., Akhtarkhavari, T., Mehvari, S., Otto, S., Mohseni, M., Arzhangi, S., Jamali, P., Mojahedi, F., … Najmabadi, H. (2019). Genetics of intellectual disability in consanguineous families. Molecular Psychiatry, 24(7), 1027‑1039. https://doi.org/10.1038/s41380-017-0012-2
Kamal, N., Khamirani, H. J., Mohammadi, S., Dastgheib, S. A., Dianatpour, M., & Tabei, S. M. B. (2022). ZNF142 mutation causes neurodevelopmental disorder with speech impairment and seizures: Novel variants and literature review. European Journal of Medical Genetics, 65(7), 104522. https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2022.104522
Khayat, A. M., Alshareef, B. G., Alharbi, S. F., AlZahrani, M. M., Alshangity, B. A., & Tashkandi, N. F. (2024). Consanguineous Marriage and Its Association with Genetic Disorders in Saudi Arabia: A Review. Cureus, 16(2), e53888.
Krami, A. M., Bouzidi, A., Charif, M., Amalou, G., Charoute, H., Rouba, H., Roky, R., Lenaers, G., Barakat, A., & Nahili, H. (2022). A homozygous nonsense HECW2 variant is associated with neurodevelopmental delay and intellectual disability. European Journal of Medical Genetics, 65(6), 104515.
Lai, M.-C., Kassee, C., Besney, R., Bonato, S., Hull, L., Mandy, W., Szatmari, P., & Ameis, S. H. (2019). Prevalence of co-occurring mental health diagnoses in the autism population: A systematic review and meta-analysis. The Lancet Psychiatry, 6(10), 819‑829. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30289-5
Mahrous, N. N., Albaqami, A., Saleem, R. A., Khoja, B., Khan, M. I., & Hawsawi, Y. M. (2024). The known and unknown about attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) genetics : A special emphasis on Arab population. Frontiers in Genetics, 15. https://doi.org/10.3389/fgene.2024.1405453
Maj, M. (2005). ‘Psychiatric comorbidity’: An artefact of current diagnostic systems? The British Journal of Psychiatry, 186(3), 182-184. https://doi.org/10.1192/bjp.186.3.182
Masri, A. T., Oweis, L., Ali, M., & Hamamy, H. (2023). Global developmental delay and intellectual disability in the era of genomics: Diagnosis and challenges in resource limited areas. Clinical Neurology and Neurosurgery, 230, 107799.
Mattioli, F., Worpenberg, L., Li, C.-T., Ibrahim, N., Naz, S., Sharif, S., Firouzabadi, S. G., Vosoogh, S., Saraeva-Lamri, R., Raymond, L., Trujillo, C., Guex, N., Antonarakis, S. E., Ansar, M., Darvish, H., Liu, R.-J., Roignant, J.-Y., & Reymond, A. (2023). Biallelic variants in NSUN6 cause an autosomal recessive neurodevelopmental disorder. Genetics in Medicine: Official Journal of the American College of Medical Genetics, 25(9), 100900. https://doi.org/10.1016/j.gim.2023.100900
Mercan, S., Akcakaya, N. H., Salman, B., Yapici, Z., Ozbek, U., & Ugur Iseri, S. A. (2023). Clinical and genetic analyses in syndromic intellectual disability with primary microcephaly reveal biallelic and de novo variants in patients with parental consanguinity. Genes & Genomics, 45(1), 13‑21. https://doi.org/10.1007/s13258-022- 01344-8
Mete, C., Bossavie, L., Giles, J., & Alderman, H. (2020). Is consanguinity an impediment to child development? Population Studies, 74(2), 139
159. https://doi.org/10.1080/00324728.2019.1699942.
Moudi, M., Vahidi Mehrjardi, M. Y., Hozhabri, H., Metanat, Z., Kalantar, S. M., Taheri, M., Ghasemi, N., & Dehghani, M. (2022). Novel variants underlying autosomal recessive neurodevelopmental disorders with intellectual disability in Iranian consanguineous families. Journal of Clinical Laboratory Analysis, 36(2), e24241.
Nejabat, M., Inaloo, S., Sheshdeh, A. T., Bahramjahan, S., Sarvestani, F. M., Katibeh, P., Nemati, H., Tabei, S. M. B., & Faghihi, M. A. (2021). Genetic Testing in Various Neurodevelopmental Disorders Which Manifest as Cerebral Palsy: A Case Study From Iran. Frontiers in Pediatrics, 9. https://doi.org/10.3389/fped.2021.734946
Nolen-Hoeksema S, Watkins ER. (2011). A heuristic for developing transdiagnostic models of psychopathology. Explaining multifinality and divergent
trajectories. Perspect Psychol Sci; 6: 589- 609.
Roy, N., Ghaziuddin, M., & Mohiuddin, S. (2020). Consanguinity and Autism. Current Psychiatry Reports, 22(1), 3. https://doi.org/10.1007/s11920-019-1124-y
Saleh, S., Beyyumi, E., Al Kaabi, A., Hertecant, J., Barakat, D., Al Dhaheri, N. S., Al Gazali, L., & Al Shamsi, A. (2021). Spectrum of neuro-genetic disorders in the United Arab Emirates national population. Clinical Genetics, 100(5), 573‑600. https://doi.org/10.1111/cge.14044
Sun, L., Yang, X., Khan, A., Yu, X., Zhang, H., Han, S., Habulieti, X., Sun, Y., Wang, R., & Zhang, X. (2024). Panoramic variation analysis of a family with neurodevelopmental disorders caused by biallelic loss-of-function variants in TMEM141, DDHD2, and LHFPL5. Frontiers of Medicine, 18(1), 81‑97. https://doi.org/10.1007/s11684-023- 1006-x
Susgun, S., Yucesan, E., Goncu, B., Hasanoglu Sayin, S., Kina, U. Y., Ozgul, C., Duzenli, O. F., Kocaturk, O., Calik, M., Ozbek, U., & Ugur Iseri, S. A. (2024). Two rare autosomal recessive neurological disorders identified by combined genetic approaches in a single consanguineous family with multiple offspring. Neurological Sciences: Official Journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology, 45(5), 2271‑2277. https://doi.org/10.1007/s10072-023-07211-y
Tuncay, I. O., Parmalee, N. L., Khalil, R., Kaur, K., Kumar, A., Jimale, M., Howe, J. L., Goodspeed, K., Evans, P., Alzghoul, L., Xing, C., Scherer, S. W., & Chahrour, M. H. (2022a). Analysis of recent shared ancestry in a familial cohort identifies coding and noncoding autism spectrum disorder variants. NPJ Genomic Medicine, 7(1), 13. https://doi.org/10.1038/s41525-022-00284-2
Word Health Organization. 2021.The ICD-11 classification of mental and behavioural disorders: diagnostic criteria for research. Geneva: World Health Organization.