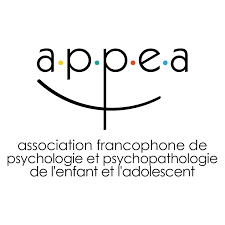Les troubles du neurodéveloppement sont à ce jour décrit dans les nosographies actuelles (DSM-5, CIM-11) par la présence conjointe de quelques critères :
• Un ou deux critères cliniques qui s’appuient sur des observables comportementaux dont l’identification ne devrait pas poser d’ambiguïté.
• Un critère de précocité dans l’apparition des premiers signes (en général durant la période de l’école maternelle).
• Un critère portant sur l’impact que le trouble a sur l’adaptation de l’enfant à ses environnements.
• Parfois, un critère d’exclusion spécifiant que le trouble ne doit pas être mieux expliqué par un autre trouble (diagnostic différentiel).
Les différents critères cliniques relèvent de l’évaluation des grandes fonctions développementales : intelligence, motricité, langage… et l’impact sur le fonctionnement renvoyant aux comportements adaptatifs et bien entendu le développement de l’enfant.
L’évaluation de ces grandes fonctions mobilise des épreuves standardisées nommées « tests » et/ou « échelles ». La standardisation concerne l’administration et la cotation. Ces tests mesurent la plupart du temps des performances : il y a donc des « bonnes » et de « mauvaises » réponses qui dépendent de l’époque et de l’âge de l’enfant. Concernant la standardisation, l’idée est de maîtriser au mieux les effets du contexte sur les performances, et de permettre la comparaison des résultats, à la fois dans une perspective inter et intrasujets. Les normes de références sont celles d’un échantillon représentatif d’un âge donné obtenu chez des enfants au développement ordinaire. Cette technique permet ainsi d’obtenir des distances chiffrées par rapport à la norme pour une fonction, une compétence ou une performance donnée et pour un âge donné.
Dans les épreuves dites « projectives », la technique est tout autre. L’enfant doit « interpréter » une situation, généralement en présentation visuelle (une tache d’encre, une photo, un dessin…). Il n’y a donc ni « bonne » ni « mauvaise » réponse, il y a la réponse de l’enfant. En soi cette technique ne pose pas de problème, si ce n’est que les cadres théoriques qui font référence relèvent le plus souvent de dogmes, dont la validation scientifique est pour le moins douteuse.
Ces épreuves sont le plus souvent présentées comme des « épreuves de personnalité », sans que ce terme soit correctement défini. Si on peut admettre que la réponse de l’enfant nous renseigne sur sa « singularité », cette dernière n’est pas pour autant un marqueur de sa « personnalité ». On entend généralement par « personnalité une certaine organisation stable des conduites, à l’âge adulte (à partir de 25 ans) qui permet de faire une certaines prédiction dans les réponses comportementales que la personne va déclencher dans des situations qui nécessitent une réponse adaptative.
Ainsi dans une tache d’encre, voir un visage (qui est une contrainte perceptive imposée par le cerveau), ou contourner cette contrainte comme dans l’autisme n’a rien avoir avec l’interprétation selon laquelle ce visage renvoie à une représentation inconsciente telle l’imago maternelle.
Ce n’est donc pas l’épreuve qui est en jeu dans cette histoire, mais l’interprétation des réponses du sujet, surtout lorsque ces dernières sont passées au tamis des dogmes. De plus, l’absence de standardisation de ces épreuves, pas tant au niveau de l’administration que de la cotation, rendent les comparaisons interpublications souvent délicates. Enfin, ces épreuves sont coûteuses en temps d’administration et de correction, et sans grand rapport avec les informations nécessaires à l’évaluation des particularités rencontrées dans les TND.
En effet, les variables qui spécifient un TND sont présentes dans les critères cliniques : elles concernent le développement cognitif et ses grandes fonctions : attention, mémoire, vitesse… le développement du langage dans ces aspects formels : phonologique, lexical, syntaxique… et dans ces aspects communicatifs, le développement de la motricité dans ses dimensions expressives et praxiques, et les comportements qui participent à l’adaptation au quotidien dans des environnements changeants.
Il n’est nulle part question d’évaluation de la “personnalité, et ceci d’autant que cette notion n’est pas très opérationnelle chez l’enfant, sinon à parler de ‘personnalité en construction’, ce qui pose de redoutables problèmes théoriques et pratiques.
C’est pourquoi ces épreuves dites” projectives » ne sont recommandées par aucune agence internationale prenant en compte les questions de santé (Voir pour la France les rapports de la HAS : Haute Autorité en Santé sur la problématique des évaluations dans les TND : TSA, TDAH, TDC, TDI…).
Pour conclure, cerner des conditions neurodéveloppementales comme les TND va nécessiter le concours et la participation de nombreux professionnels, des parents et l’enfant bien entendu. C’est dans le regard croisé des observations proposées par ces derniers qu’un diagnostic pourra être proposé. Dans les informations nécessaires à cette démarche, il n’est nullement question de « personnalité » au sens où certains modèles théoriques, notamment la psychanalyse l’entend. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas aborder la question de la compréhension, de l’expression et de la régulation des émotions, mais les épreuves projectives n’ont pas été crées pour cela.